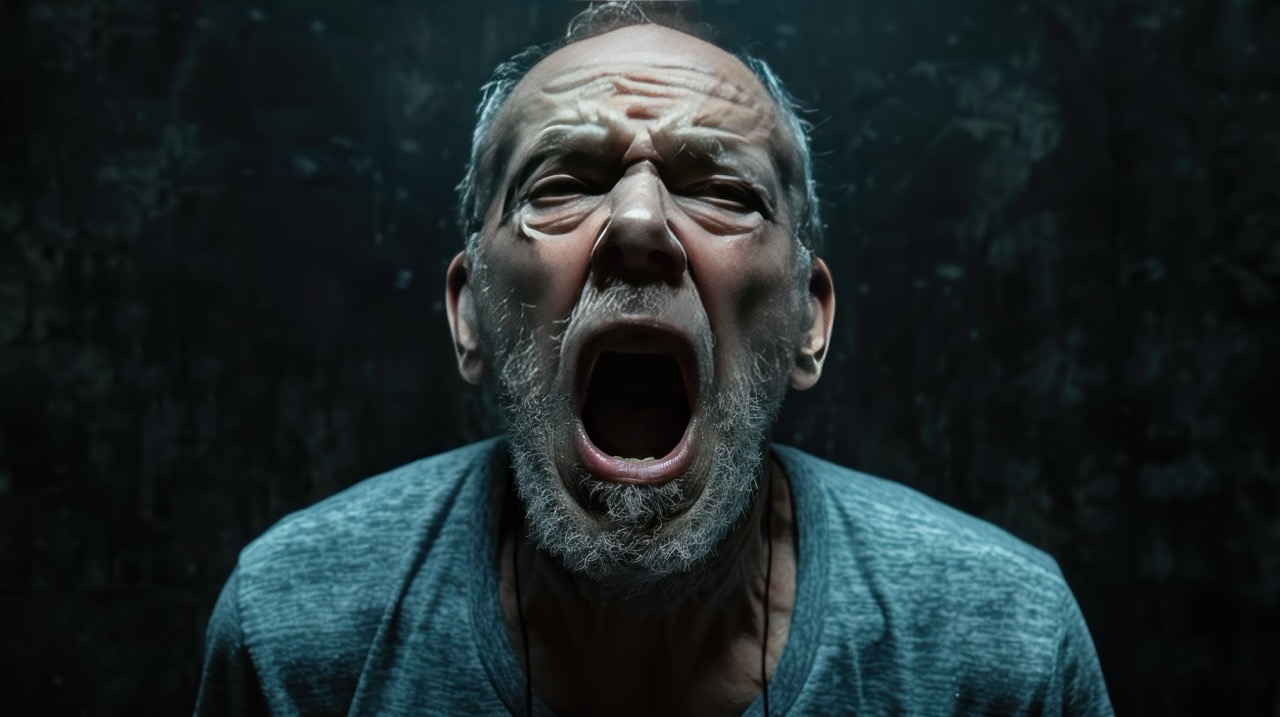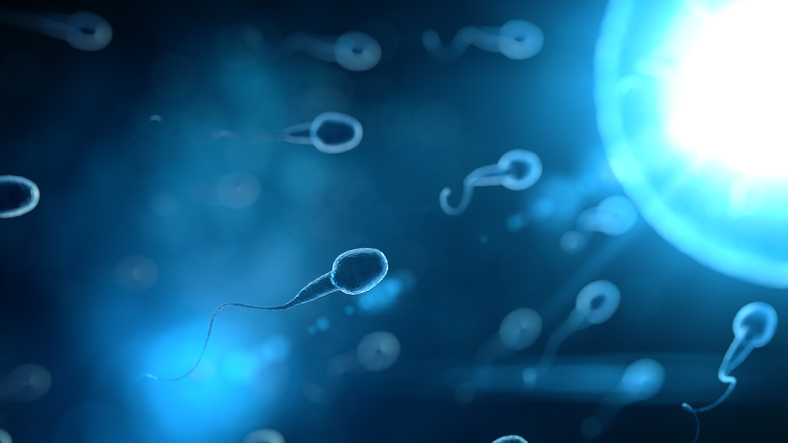Une équipe de l’UZ Leuven et de la KU Leuven propose une nouvelle façon de caractériser le rejet après transplantation rénale, en s’appuyant sur un modèle mathématique construit à partir de 19 500 biopsies de 8 873 patients, recueillies dans dix centres de transplantation à travers le monde.
Publiée dans Nature Communications, cette étude, la plus vaste jamais réalisée dans ce domaine, vise à dépasser les limites de la classification de Banff, encore centrée sur un nombre restreint de catégories, pour offrir une évaluation beaucoup plus fine de l’intensité, de la chronicité et des mécanismes sous-jacents du rejet.
Le rejet reste une complication fréquente : malgré une immunosuppression au long cours, environ un tiers des receveurs de greffe rénale y sont confrontés tôt ou tard. Il s’agit d’un processus continu, lié à la mismatch inévitable entre donneur et receveur, pouvant impliquer à des degrés variables les cellules de l’immunité et les anticorps préformés ou acquis. Sur le plan histologique, il se manifeste par une inflammation de l’allogreffe, dont la sévérité s’étend de formes subtiles à des tableaux susceptibles de conduire à la perte du greffon et au retour à la dialyse ou à une nouvelle transplantation.
Dans ce contexte, la biopsie rénale reste la référence pour documenter le rejet. Toutefois, la classification de Banff confirme principalement la présence de rejet et distingue quelques sous-types, sans rendre pleinement compte du caractère graduel et multifactoriel du processus. Le modèle développé par l’équipe de Leuven propose au contraire une approche en quatre dimensions : il quantifie, pour chaque biopsie, le caractère plus ou moins aigu du rejet, son degré de chronicité, ainsi que la contribution relative des mécanismes cellulaires et des mécanismes médiés par les anticorps. Cette représentation continue permet de mieux saisir la dynamique de la maladie, de la phase infraclinique aux formes sévères, et d’affiner le choix thérapeutique.
L’étude montre par ailleurs que ces nouvelles dimensions ont une portée pronostique directe. Chaque augmentation d’un point de l’activité de la maladie ou du degré de dommage chronique est associée à une hausse de 15 à 20 % du risque de perte du greffon, et ce de manière cohérente dans l’ensemble des centres de transplantation analysés. Ces résultats suggèrent que le score multidimensionnel ne se limite pas à une description histologique plus sophistiquée, mais apporte une information cliniquement pertinente pour stratifier le risque et guider la prise en charge. À l’UZ Leuven, ces paramètres sont déjà intégrés en routine par la pathologiste rénale, afin d’identifier plus finement les patients nécessitant une intensification de l’immunosuppression ou des traitements antifibrotiques.
Les auteurs soulignent enfin l’impact potentiel de ce travail sur les futures recommandations internationales. Tous les deux ans, un groupe de travail mondial, présidé par le Pr Maarten Naesens, révise et affine la classification du rejet. Le modèle élaboré à Leuven devrait, selon toute vraisemblance, être progressivement intégré dans ces lignes directrices.
L’équipe de rédaction Tempo Today