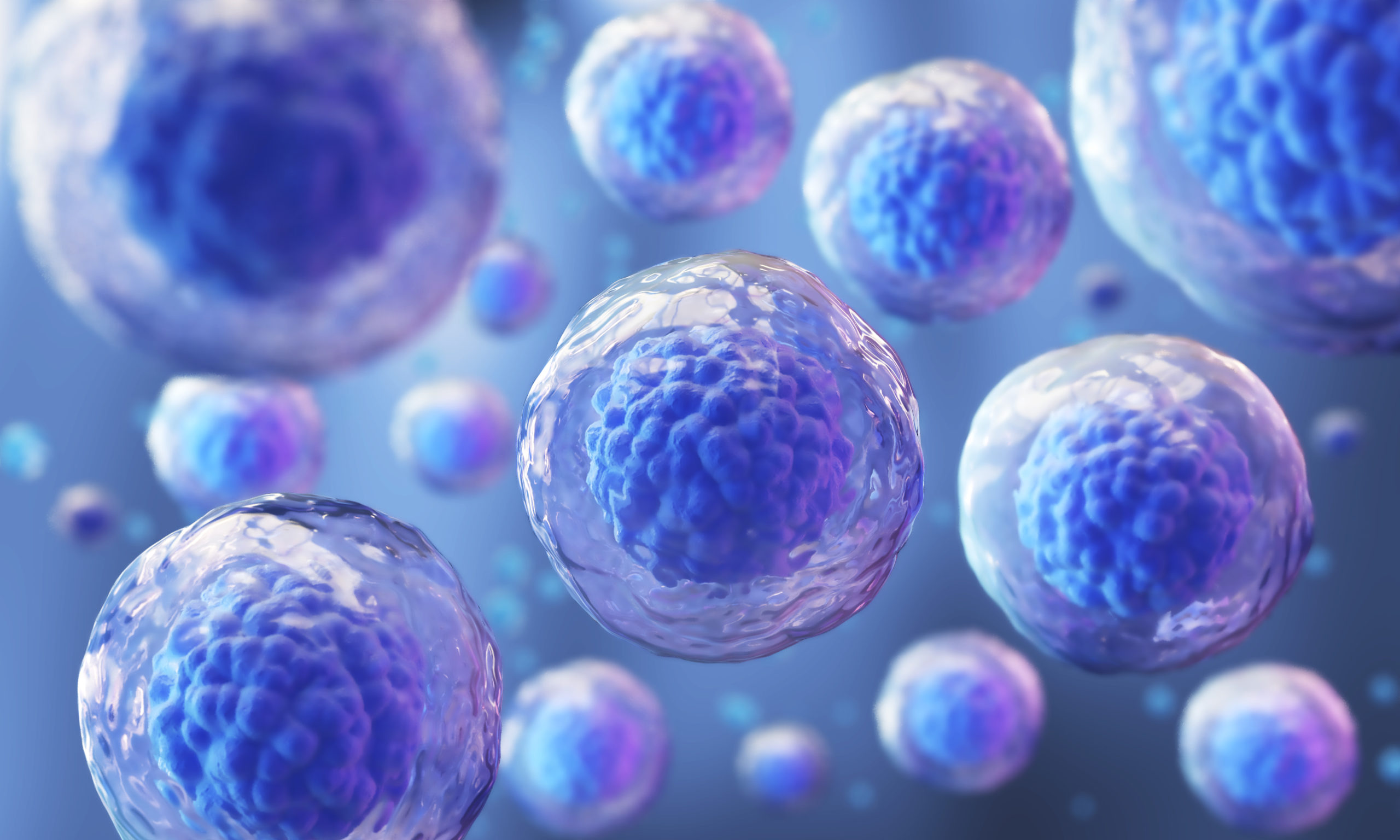L’impression 3D transforme progressivement la gastro-entérologie en offrant des applications allant de la formation médicale à la conception d’implants sur mesure. Une revue retrace l’évolution de cette technologie, ses usages actuels et son potentiel dans la pratique clinique.
Développée dans les années 1980, l’impression 3D permet de créer des objets en superposant des couches de matériaux à partir d’un modèle numérique. En médecine, elle a d’abord servi à produire des prothèses, des implants orthopédiques et des outils chirurgicaux, avant d’atteindre le domaine gastro-entérologique.
Aujourd’hui, ses principales applications concernent la modélisation anatomique (préparation d’interventions complexes du foie, du côlon ou de l’œsophage), la simulation de formation endoscopique et le développement de prothèses expérimentales telles que les stents œsophagiens et biliaires. Ces dispositifs, personnalisables selon l’anatomie du patient, pourraient réduire les coûts et améliorer la précision thérapeutique, bien qu’aucun n’ait encore obtenu d’autorisation commerciale après essais cliniques.
L’impression 3D ouvre aussi la voie à la bio-ingénierie tissulaire, notamment via l’utilisation d’hydrogels biocompatibles pour cultiver des modèles d’intestin humain ou régénérer les voies biliaires. Les progrès récents en bioprinting hépatique laissent entrevoir la possibilité future de greffes d’organes imprimés à la demande.
Malgré son potentiel, la technologie doit encore surmonter des défis majeurs : standardisation des procédés, encadrement réglementaire et sécurisation des matériaux implantables. La FDA travaille déjà à définir des directives pour garantir la qualité et la sécurité de ces dispositifs médicaux.
À terme, l’impression 3D pourrait offrir à la gastro-entérologie des dispositifs personnalisés, abordables et accessibles à grande échelle, favorisant la démocratisation des soins.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
L’équipe de rédaction Tempo Today