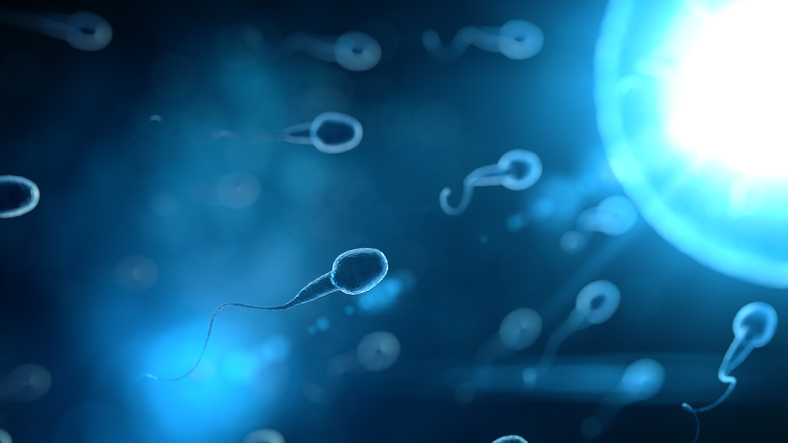Les pratiques agricoles mondiales aggravent le stress thermique et la pression sur les ressources en eau, alertent les chercheurs de la VUB.
Avec la croissance démographique et l’augmentation des besoins alimentaires, la surface des terres équipées pour l’irrigation a été multipliée par près de six depuis 1900. Trois études dirigées par le Dr Yi Yao (Vrije Universiteit Brussel et ETH Zurich) montrent que cette expansion n’a pas seulement des effets sur les rendements agricoles, mais aussi sur la santé humaine, en aggravant le stress thermique humide et en accentuant la pression sur les ressources en eau douce. Ces travaux soulignent la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’irrigation et de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour protéger à la fois la production alimentaire et la santé des populations.
Dans une première étude, les chercheurs ont utilisé des données historiques d’irrigation couvrant la période 1901–2014, combinées à six modèles du système terrestre, pour évaluer son impact sur les épisodes de chaleur extrême. Ils montrent que, dans les régions fortement irriguées, l’irrigation fait baisser la fréquence des températures d’air très élevées, mais qu’en augmentant l’humidité, elle réduit beaucoup moins le stress thermique dit « humide ». Or, ce type de chaleur est particulièrement dangereux pour la santé, car l’humidité élevée limite la capacité du corps à se refroidir. Dans certaines régions, l’irrigation a même aggravé ce stress thermique humide, au point de potentiellement mettre en danger des millions de personnes exposées à ces conditions.
Une deuxième étude projette l’évolution future des risques de chaleur sèche et humide selon différents scénarios d’émissions et de pratiques d’irrigation. Si l’irrigation peut modérer en partie les extrêmes de chaleur sèche, elle ne peut compenser le réchauffement global. Les simulations montrent que les populations devront faire face à un nombre bien plus élevé d’heures de chaleur humide extrême chaque année, notamment dans certaines régions tropicales où les conditions deviendront extrêmement difficiles à supporter pour la santé humaine.
La troisième étude s’intéresse aux ressources en eau douce. En utilisant sept modèles avancés du système terrestre, les chercheurs montrent que l’expansion de l’irrigation depuis 1901 a fortement augmenté les pertes d’eau par évapotranspiration, sans compensation par les précipitations locales. Autrement dit, plus d’eau est extraite et renvoyée dans l’atmosphère qu’il n’en revient par les pluies, ce qui entraîne un déficit progressif des réserves en eau terrestre. Dans certaines régions agricoles clés, comme l’Asie du Sud et le centre-nord de l’Amérique du Nord, les stocks d’eau dans les sols, les rivières et les nappes phréatiques ont diminué jusqu’à 500 mm entre 1901 et 2014, mettant en péril la sécurité hydrique à long terme et, par ricochet, la santé des populations dépendantes de ces ressources.
Pris ensemble, ces travaux montrent que le « refroidissement » apparent de l’air par l’irrigation ne raconte qu’une partie de l’histoire. En augmentant l’humidité de l’air et en épuisant les ressources en eau douce, l’irrigation peut en réalité accroître les risques pour la santé humaine, en particulier dans les régions déjà vulnérables aux vagues de chaleur et au stress hydrique. La planification de l’adaptation au changement climatique ne peut donc pas se limiter à étendre l’irrigation : elle doit en améliorer l’efficacité et, surtout, s’accompagner d’une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre pour limiter les impacts combinés de la chaleur, de l’humidité et des pénuries d’eau sur la santé et la sécurité alimentaire.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
L’équipe de rédaction Tempo Today