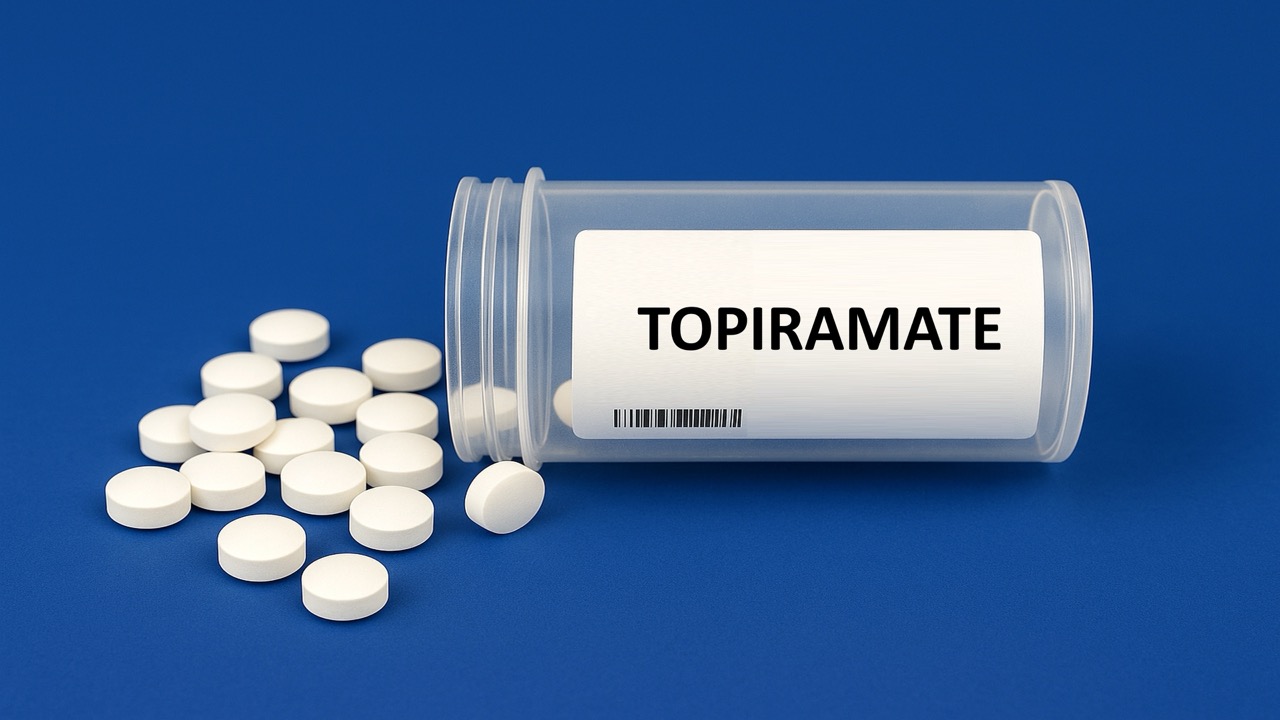Les agonistes des récepteurs du GLP-1, déjà utilisés dans le traitement du diabète et de l’obésité, pourraient également améliorer le contrôle de l’asthme chez les patients obèses. Lors du CHEST Annual Meeting 2025 à Chicago, la Dr Sunanda Tah (Camden Clark Medical Center, West Virginia University) a présenté une étude rétrospective suggérant une réduction significative des exacerbations et de la consommation de corticoïdes systémiques chez ces patients.
L’obésité concerne près de 40 % des adultes asthmatiques, contre 27 % dans la population sans asthme, et elle aggrave le contrôle de la maladie. L’excès de tissu adipeux favorise une inflammation systémique et bronchique par la sécrétion de cytokines telles que l’IL-6, l’IL-1β, le TNF-α et la leptine, réduisant la compliance pulmonaire et la réponse aux corticoïdes. Ce déséquilibre métabolique entretient un cercle vicieux : les corticoïdes provoquent une prise de poids et une résistance à l’insuline, accentuant à leur tour l’inflammation et la sévérité de l’asthme.
Les agonistes du GLP-1, tels que le sémaglutide, le tirzépatide, le liraglutide, l’exénatide et le dulaglutide, présentent un double intérêt : ils améliorent la sensibilité à l’insuline et réduisent l’inflammation, indépendamment de la perte pondérale.
L’étude de Tah et al. a exploité les données de la base TriNetX sur une période de 5 ans, incluant 2 132 adultes obèses (IMC ≥ 30 kg/m²) souffrant d’asthme et recevant une bithérapie standard à base de budésonide-formotérol. Parmi eux, la moitié prenait en plus un agoniste du GLP-1. Les résultats montrent que 4,4 % des patients sous GLP-1 RA ont présenté une exacerbation contre 9,6 % dans le groupe témoin (p < 0,001), et 16,2 % ont eu recours à la prednisone contre 27,6 % sans traitement par GLP-1 RA (p = 0,002).
Selon la Dr Tah, ces résultats soutiennent l’hypothèse d’un modèle de gestion métabolico-respiratoire de l’asthme, où les médicaments métaboliques pourraient réduire l’inflammation bronchique et la dépendance aux corticoïdes. Elle souligne toutefois les limites méthodologiques de l’étude rétrospective et la nécessité d’essais prospectifs pour confirmer ces observations.
Référence : pour en savoir plus, cliquez ici.
L’équipe de rédaction Tempo Today